
Sylviane Chatelainová
J’ai eu l’envie d’écrire aussi loin que je me souvienne...
l´entretien
- A quel moment avez vous eu l’envie de commencer à écrire des romans et des nouvelles ?
- J’ai eu l’envie d’écrire aussi loin que je me souvienne. Déjà quand j’étais à l’école, j’avais un grand amour pour la littérature, c’était une espèce de rêve qui m’a paru complètement inaccessible, que je me sentais incapable de réaliser. J’ai commencé comme tout le monde à tenir un journal, dans lequel j’ai noté tout ce qui me passait par la tête. Et je me suis rendue compte petit à petit qu’en écrivant ce qui m’arrivait, je glissait dans la fiction. J’ai donc commencé à écrire dans un gros cahier rouge des idées pour des nouvelles que j’ai récupérées par la suite. C’était très intense mais il a fallu que je sois un peu forcée. L’écriture m’attirait et en même temps inquiétait – j’avais l’impression que c’était un travail très solitaire, que c’était comme entrer dans un couvent, que c’était une décision qui impliquerait toute ma vie.
Je devais me pousser un peu. Au début je faisais d’autre choses, j’ai eu quatre enfants, j’ai recommencé les études, j’ai fait plein de choses et un jour où j’ai du déménagé de Neuchâtel à Genève puisque mon mari y a trouvé du travail, je me suis trouvée très loin de l’université (j’ai commencé mes études à Neuchâtel), et j’ai du abandonner, je n’arrivais pas concilier les cours, les enfants, la distance. Et je me suis retrouvée pour la première fois n’ayant rien à faire a part de m’occuper de la famille. Et c’est là où j’ai repris d'anciens textes et j’ai essayé de les travailler, de les achever. Au bout de quelque temps, j’en avais écris une dizaine, j’ai participé à un concours de nouvelles et j’ai gagné le premier prix. La présidente du jury était l’écrivaine Gabrielle Faure, qui a beaucoup aimé mes nouvelles et elle m’a proposé de les faire lire à son éditeur. De cette façon j’ai pu publier mon premier recueil de nouvelles sans avoir du chercher un éditeur. Et après ça s’est enchaîné.
- Et cette publication vous a encouragé pour la suite.
- Oui, elle m’a encouragé, j’ai eu d’assez bonnes critiques et comme je doutais énormément, cela m’a fait du bien. J’ai essayé d’écrire un roman tout de suite après. Et j’ai continué.
- Est-ce que d’être écrivain vous a aidé d’une certaine manière dans votre vie ? Ou plutôt le contraire ?
- C’est très ambiguë. Je pense que l’écriture m’a énormément apporté parce que je savais que c’est ça que je devais faire. Je le repoussais par peur de ne pas pouvoir y arriver, de n’en pas être capable. Mais une fois que vous avez fait le pas, vous avez fait ce qu’il fallait et lorsque vous avez réussis un livre, c’est une grande satisfaction. De ce point de vue ça m’a aidé. D’un autre côté, ce que je pressentait en refusant à m’y mettre, le fait que c’est un métier très difficile, qui exige une grande solitude et de doutes, c’est vrai et quelques fois je suis sur le fil de rasoir. Si on n’est pas très bien, si l’on est inquiet, on a des problèmes, des angoisses, il est plus facile d’aller se promener ou d’aller faire des magasins au lieu d’aller s’installer à son bureau pendant quatre heures devant une page blanche dans le silence. D’un autre côté c’est une grande satisfaction mais de l’autre c’est très difficile. Je ne peux pas dire que l’écriture me fait du bien directement.
- Comment vit votre famille ces moments de solitude ? Est-ce qu’ils vous encouragent ?
- Au début, quand j’ai commencé à écrire, les enfants étaient petits. J’ai essayé d’écrire quand ils n’étaient pas là, très tôt le matin, un peu le soir, parce que j’ai toujours voulu être là pour eux, je n’ai pas voulu avoir de regrets plus tard en me disant que je travaillais et que je ne les voyais pas grandir. Après je me suis adaptée aux heures d’école. C’était très bien, j’arrêtais quand ils rentraient. Ils savaient ce que je faisais - pour eux c’était quelque chose de normale. Après ils sont devenu grands, ma fille la plus jeune a 23 ans, ils ont tous leur vies. Mon mari et mes enfants sont toujours mon premier public, je leur montre mes nouvelles, on en discute. Ils aiment tous énormément lire, je crois que ça les intéresse beaucoup. J’apprécie beaucoup leurs remarques.
- Votre premier recueil de nouvelles Les Routes blanches a été publié aux éditions de l’Aire, après vous avez changé l’éditeur pour quelle raison?
- C’était tout à fait par hasard. L’Aire était l’éditeur de Gabrielle Faure, à l’époque c’était une maison d’édition assez grande pour la Suisse romande. Je n’ai pas eu le contact direct avec l’éditeur mais avec quelqu’un qui a quitté la maison d’édition après. Donc je me suis retrouvé dans l’obligation de présenter mon deuxième livre à un éditeur que je ne connaissais pas. Entre deux, j’ai rencontré au Salon du Livre à Genève Bernard Campiche qui était un jeune éditeur très passionné par son métier. On a eu un très bon contact et je lui ai confié mes livres. Je ne regrette pas de tout. C’est une maison plus petite, il nous connaît donc tous et comme je ne suis effectivement pas très sûre de moi, il est très encourageant d’avoir un éditeur à qui on peu téléphoner, qui donne très vite son opinion sur ce qu’on lui soumet, qui est très présent. C’est très agréable.
- Vos romans et vos nouvelles, à l’exception des Routes blanches, ont une forme spécifique, souvent avec des passages très courtes. C’était votre choix d’organiser le récit ainsi ?
- Oui, c’est moi qui décide de faire ainsi déjà sur mon manuscrit – les paragraphes, les sauts de pages, de faire les livres très aérés comme ça. Et Bernard Campiche le respecte, il accepte volontiers ce genre de choses même si plus de pages coûtent plus d’argent. J’ai eu beaucoup de chance avec la publication de mon premier recueil mais en ce qui concerne l’organisation de texte j’ai été déçue. C’était écrit tout petit, très serré, très compact. Quand j’avais le recueil entre les mains, j’ai été vraiment déçue par rapport à l’idée que je me faisait de mes nouvelles. C’est aussi pour cela que je suis très contente chez Bernard Campiche.
- Vos textes sont très poétiques. Quel rapport avez vous à la poésie ?
- La poésie est quelque chose qui me paraît magnifique, je la lis volontiers mais je n’ai jamais écris un poème. Je n’arrive pas à écrire de poèmes parce que j’aime trop parler des gens. Il est très difficile d’écrire un poème en introduisant l’histoire de quelqu’un. J’aime écrire les nouvelles parce que c’est un peu l’alliage de la poésie et de l’histoire de l’homme, de son destin. On peut nouer les deux dans une nouvelle : on est très allusive, très dense, on va tout de suite au cœur du sujet. Ceci me permet d’être poète tout en parlant de l’être humain, de son histoire. C’est ça qui m’intéresse.
- Vous écrivez les nouvelles et les romans. Quelle forme préférez vous ?
- J’aime énormément les nouvelles. Je crois que je préfère écrire de nouvelles. J’essaie toujours d’organiser un recueil de nouvelles autour d'un thème que chacune des nouvelles explore à sa façon, elles ont ainsi un lien entre elles. Mais à moment donné, au bout de dix nouvelles, j’ai l’impression que j’ai finit sur ce thème-là, que le recueil est terminé. Il est aussi assez fatiguant d’écrire les nouvelles justement parce que c’est quand même de la poésie. Il faut être très concentrée sur l’histoire autrement on la perd vite. Il faut un grand moment de concentration pour la réussir et après il faut se replonger dans une autre qui a un autre climat. J’ai un peu l’impression d’être un voyageur qui va d’une ville à l’autre, il faut faire ses bagages et repartir, c’est passionnant au départ mais au bout d’un moment on a envie de s’installer quelque part un peu plus longtemps. En même temps, en écrivant des nouvelles, il y a des thèmes, des questions qui se posent à travers de ces nouvelles, qu’on aimerait explorer plus tranquillement. Alors vient le séjour de deux ou trois ans dans un roman et ensuite naît le désir de repartir. Par exemple, mon deuxième roman, Le Manuscrit, s'est développé autour d'un noyau central qui est une reprise d'une nouvelle écrite auparavant. Et il arrive aussi qu'en écrivant un roman, je garde en réserve des questions qu'il soulève et qui deviendront le sujet de nouvelles. Les deux genres se complètent bien. Pour le moment je le fais comme ça mais peut-être après j’écrirai seulement de nouvelles parce que c’est ce que je préfère.
- Dans votre dernier livre, Le Livre d’Aimée, l’écrivaine est explicitement présente, il s’agit d’une vraie rencontre entre elle et le personnage, néanmoins ça reste une rencontre tout à fait aléatoire pour l’écrivaine, comme si le personnage s’imposait lui même à l’écrivaine. Avez vous le même sentiment avec tous vos personnages ?
- Oui, c’est vrai, avec tous mes personnages et toutes mes histoires. Mais c’est très difficile à dire comment vienne l’idée d’écrire sur un personnage. J’ai toujours l’impression qu’au départ il y a une image. Je vois beaucoup de choses par images, je dois être très visuelle. Par exemple dans Livre d’Aimée, la première image que j’ai eue, c’était l’image de la petite fille, la grille, le mur, la maison et ces hommes qui montent et descendent. C’est cette image qui s’est imposée. Après elle s’anime. Je suis un peu le fil de l’histoire, je transcris l’histoire qui se passe dans ma tête, qui s’impose complètement. Je ne peux pas dire d’où ça vient, je peux mieux comprendre quand le livre est finit. Je cerne mieux le problème. L'image vient en général d’une rencontre entre un événement extérieur et une préoccupation intérieure, consciente ou non, c'est une espèce de choc qui crée l’image et ensuite les personnages apparaissent.
L’histoire de la petite fille dans Le Livre d’Aimée a donné naissance à l’histoire d’une bande dessinée. J’ai commencé à écrire l’histoire de la petite fille comme une nouvelle et sans le vouloir, j’ai réalisé que c’était une bande dessinée plus qu’un film. J’ai été gênée pour écrire ma nouvelle sur cette forme-là, donc j’ai décidée d’accepter le fait que c’était une bande dessinée. Et j’avais l’envie de mettre cette bande dessinée dans les mains de quelqu’un, donc j’ai crée ce deuxième personnage, un nouveau cercle d’histoire. C’était un peu comme des poupées russes. Dans le deuxième cercle il y a une femme qui lit la bande dessinée. Cette femme, c’était exactement comme je la décris dans mon livre : chaque matin je la trouvais dans mon bureau, je ne savais pas d’où elle venait, j’avais beaucoup de peine à maîtriser ce personnage. Elle ne voulait pas se laisser faire, ne voulait pas agir ni m'entraîner dans son histoire. Elle était insaisissable et pourtant décidée à ne pas se laisser écarter, comme si c'était elle qui exigeait de moi des réponses à ses questions. Cette tête-à-tête était un peu embarrassante et il m’est donc venue cette idée d’introduire le troisième cercle, l’histoire de cet écrivain et ses rapports avec son personnage. Et là, curieusement, tout était en place.
- Marc ou Carl sont des écrivains dans votre roman Le Manuscrit. Sa femme se plaint du regard qu’il pose sur les gens. Il les regarde tout en les tenant à distance, pour arrêter le souvenir, à la recherche d’une image. Ca vous arrive d’observer votre entourage ainsi ?
- Ce texte est justement né de ce genre des questions. On m’a souvent posée la question sur mes inspirations dans ma famille, comment ils réagissent, quelles sont les relations entre nos vie vécues et la fiction. C’est ça qui m’a donné l’envie d’écrire une fois une histoire que je présente comme la réalité, ce qui arrive vraiment aux personnages – il s’agit de la première partie du livre. La deuxième partie du livre, c’est la même histoire mais écrite par l’écrivain, donc on voit qu’il y a une différence. Effectivement, j’utilise tout ce que je vois, tout ce que je ressens, mais d'une telle manière que les modèles ne se reconnaissent pas. Mais comment ils le ressentent ma façon d'observer ? Je ne crois pas que ça les gène beaucoup mais il faudrait leur poser la question.
- Néanmoins la femme de l’écrivain dans Le Manuscrit a vraiment de la peine à accepter cette distance.
- Oui, l’écrivain dans Le Manuscrit veut garder la distance, sinon il ne verrait pas de choses, il serait trop impliqué, trop près. J’avais aussi pensé à une petite nouvelle de Thomas Mann qui m’a beaucoup impressionnée dans laquelle il raconte qu’il arrive dans un restaurant d’un village où il y a une fête et il se rend compte qu’il n’est pas comme les autres, qu’il a toujours cette distance, qu’il ne participera jamais. Il y a une sorte de regret de ne pas pouvoir s’amuser comme tout le monde parce qu’il est en retrait. C’est quelque chose que je trouvais très juste. J’ai souvent le sentiment d’être en retrait, mais pas dans ma vie de famille. Là j’oublie l’écriture. Par contre mes enfants le savent très bien et me disent souvent : « arrête de regarder les gens comme ça ». Parce qu’il m’arrive d’être dans un restaurant et tout à coup je ne dis plus rien et je vise quelqu’un parce qu’il y a une prise de conversation qui m’a accroché, un visage qui me plaît et je ne peux pas m’empêcher, ça me fascine, j’invente tout de suite une histoire. Mais peut-être c’est ce qui dérange ma famille, c’est une inquiétude permanente dans les périodes où j’ai de la peine à écrire, où je suis un peu triste. Mais je ne pense pas qu’ils aient l’impression que je les tienne à distance. Je n’ai aussi jamais directement parlé d’eux, j’ai parlé d’enfants, des relations familiales, mais pas d’eux. Dans mes livres, ceux qui me connaissent ont l’impression que tout, les lieux, les gens, les situations, leur sont familiers, mais d'une manière diffuse, sans que jamais ils puissent mettre un nom sur un personnage ou un lieu. C’est un peu comme si j’étais un peu partout et nulle part. Je n’ai jamais voulu les impliquer.
- Le Haut Plateau dont vous parlez dans Le Manuscrit c’est la région où vous vivez actuellement?
- Oui, c’est la région d’ici.
- Pourquoi ce Haut Plateau dépeuplé dans Le Manuscrit ?
- C’est en suivant les événements. J’ai l’impression qu’en Europe on est en train se fermer, qu’il y a tous ces gens à l’extérieur qui essaient d’entrer chez nous, tous ces réfugiés qui essaient de traverser les frontières, et on les chasse et on se ferme. Le monde est toujours plus vieux, toujours moins dynamique, j’ai vraiment l’impression que notre société occidentale est en train de s’enfermer dans son cocon et à l’extérieur sont ceux qui aimeraient participer à cette richesse. Et ce déséquilibre est tellement grand qu’il suffirait de très peu, d’une épidémie, d’un accident de centrale nucléaire, d’attentats terroristes qui déstabilisent tout, un grain de sable pour que ces gens entrent et ils auraient raison de vouloir profiter, il y a trop longtemps que nous profitons d’eux.
On ne peut pas comparer des événements mais j’ai fait du latin à l’école et je me suis beaucoup intéressée à l’histoire de Rome et de l’Empire Romain. Il s’agit un peu de ça. C’est cette fermeture des frontières, une immense armée occupée à garder les frontières, une société vieillissante à l’intérieur, les problèmes économiques et un jour « les barbares » sont entré. Alors j’ai imaginé cette situation.
- Cette entrée des réfugiés est évoqué d’une manière très sombre dans votre roman.
- Oui, parce qu’on imagine ces gens qui arrivent par vagues successives, qui s’installent, et les habitants des pays envahis une fois qu’ils ont compris qu’ils ne pouvaient plus endiguer ce flot, se réfugient dans les montagnes donc les villes sont livrées au pillages. Ces situations du changement de monde, du changement de civilisation sont terribles. Quand on lit des livres sur la fin de l’Empire Romain, c’est effroyable : il y a des villes qui sont saccagées, pillées, les envahisseurs partent plus loin, alors les gens se reconstruisent, il y a une autre vague qui arrive, il y a des épidémies, c’est une période de chaos.
- Les personnages du Manuscrit se réfugient dans la maison de Carl alors que le village se dépeuple. Ceci provoque une énorme angoisse chez les personnages.
- Oui, parce que c’est la fin de leur monde. Je ressens cette angoisse parce que j’ai l’impression que chez nous ce ne va pas très bien. On est un vieux monde, il prend énormément d’énergie pour le préserver, le maintenir tel qu'il est et les décisions courageuses ne sont pas prises du tout. Au niveau économique on fonce droit dans le mur avec notre idée de la croissance qu’il faut absolument monter au lieu de mettre en cause ce système qui de toute évidence ne fonctionne plus. Avec un peu de bon sens on se rend compte que l’on ne peut pas toujours produire plus, consommer plus. Notre système est en train de se désagréger, et puis on rafistole. Il y a de temps en temps quelqu’un qui ose lever la voix pour dire que l’on peut vivre autrement, qu’on peut changer, qu’il y a rien d’inévitable à vivre comme ça.
- Vos personnages se trouvent dans les situations difficiles, dans lesquelles ils agissent souvent avec une sérénité, un calme et une certaine sagesse. Pensez vous qu’on devrait garder une certaine sérénité dans les situations difficiles ?
- Par exemple dans la nouvelle De l’autre côté, où je décris la période de crise qui suit la mort d’un enfant, la mère ne réagit pas au début d’une manière tout à fait sereine. Dans les nouvelles je prend souvent un personnage dans un moment de crise quand sa vie est en train de basculer, quand il perd ses repères. La crise est quelque chose de très douloureux. Si l’on s’en sort, la conséquence est qu’on se connaît mieux, qu’on a su gérer un problème. On a peut-être l’attitude plus sereine parce que justement on a découvert en soi des potentialités qu’on ne connaissait pas, on se découvre, on découvre en soi des possibilités de rebondir, de s’en sortir, des profondeurs qu’on ignorait. Je pense que quelqu’un qui n’a jamais eu des problèmes aurait de la peine à se connaître.
- Dans Le Manuscrit le personnage principal découvre la jeune fille dans la maison de son mari mais cette découverte ne provoque pas chez elle une réaction de jalousie, au contraire, la crise rapproche les personnages au lieu de les séparer (ce qui arrive dans la vie réelle).
- Ceci doit effectivement correspondre à mon caractère. J’aime énormément les gens, ils m’intéressent, leur histoire me passionne. Bon, je suis aussi capable de me mettre en colère, de crier ou d’être jalouse, tout le monde est sujet à ça, tout le monde peut se mettre en colère, mais au-delà de ça, si l’on va assez profondément, si l’on ne reste pas qu’à la surface, je pense qu’on arrive toujours à parler, à discuter, à se connaître, à se comprendre et que finalement on partage nos problèmes. Parce que les gens ont les mêmes craintes, les mêmes douleurs, la peur de la maladie ou de la mort. C’est ça qui m’intéresse : de retrouver ce monde qu’on a, de descendre assez profondément pour connaître soi-même. J’ai toujours l’impression qu’on ne peut rejoindre les autres qu'en passant par des souterrains. A la surface on se connaît mal, on communique mal, si on arrive de faire ce chemin-là, on se connaît mieux et on connaît mieux des autres.
- C’est vrai que les personnages arrivent souvent à prendre du temps à se connaître. On sent votre amour pour l’homme en général.
- Tant mieux. Je préfère ça que les reproches qu’on m’a fait au sujet de L’étrangère par exemple. Ce récit d’une prisonnière violée a énormément choqué des gens. C’est là où l’on voit à quel point les gens sont touchés si un sujet est présenté sous forme poétique. Je faisais remarquer aux gens qu’il y a pire que ça, dans les journaux par exemple. Ça les choquait plus de le lire dans une nouvelle.
- Néanmoins le personnage du gardien de prison, malgré ses actions, dégage une certaine humanité.
- J’ai donné à ce personnage la possibilité d’avoir de remords puisque j’avais un peu pitié de lui. Au départ il est un « bourreau » parce qu’il a été formé comme ça par la société juste après la guerre. Il accepte d’être ce gardien du camps prisonnier, il agit comme un bourreau mais peu à peu ses certitudes et sa bonne conscience se lézardent. Parce qu’il rencontre cette fille, parce qu’il se rend compte qu’il est touché par elle, parce qu’il est pris de remords. Il y a quelque chose qui s’introduit en lui qui le touche là où il est encore humain. Et cet « encore humain » se réveille et finit par prendre le dessus, puis finalement il se compromet totalement et sort du système. C’est une sorte de rédemption, il va être ruiné, peut-être exécuté, je ne sais pas comment la nouvelle pourrait finir dans le système totalitaire comme celui-là. C’était une chance que lui a été donné de redevenir un homme. Même s’il doit mourir, avant de mourir il va redevenir un homme. C’est pour cela que je ne trouve pas cette nouvelle si pessimiste.
- Dans la nouvelle Un temps pour rien (Routes Blanches) vous dites : « il y a tout de même un temps pour tout, l’enfance pour pleurer dans les bras de sa mère, l’adolescence pour faire des rêves impossibles à réaliser et toute la vie après pour les oublier et se conduire enfin raisonnablement ». C’est l’opinion de la plupart de gens, d’être raisonnable. Que pensez vous de cette attitude dans la vie réelle ?
- C’est la mort avant terme, la mort en pleine vie. Parce qu’il y a beaucoup de gens qui sont morts avant mourir vraiment. On a l’envie de les réveiller, de leur dire : « réalisez vos rêves, il faut essayer d’y croire ». C’est justement ces moments de crise qui sont précieux, ce sont ces moments qui réveillent les hommes qui sont trop endormis par leurs certitudes.
- Les souvenirs sont omniprésents dans vos textes, les images d’un moment précis, le père derrière la fenêtre à l’hôpital, les livres dans la cour d’école, qui nous reviennent sans cesse, néanmoins ils ne nous réconfortent pas, ils nous poursuivent…
- …oui, qui nous donnent une certaine angoisse. C’est vrai, peut-être cela vient du fait que mon père était très malade, j’ai eu pas mal de problèmes quand j’étais jeune, donc j’ai effectivement cette impression d’avoir été marquée, poursuivie par des souvenirs. Tant qu’ils sont enterré, pour ne pas en prendre compte, c’est là où ils font du mal. Si l’on arrive à les sortir de là où ils sont enterrés, à les mettre à la lumière, si l’on arrive à en faire le tour, à mettre le doigt là où ça fait mal, ils deviennent positifs. On peut les utiliser pour mieux se connaître, pour réagir par rapport à ce passé plutôt que se laisser écraser par lui. Ou bien on laisse les souvenirs nous écraser, ou bien on se bat avec eux d’une certaine façon, c’est à dire de les mettre en pleine lumière.
- Est-ce que l’écriture est le moyen d’affronter les souvenirs qui nous poursuivent ?
- Oui, c’est le moyen d’affronter les souvenirs et d’autres choses aussi. C’est un de mes thèmes. L’autre thème qui revient souvent c’est pourquoi on écrit, peint ou fait de la musique, ça revient tout le temps et le jour où je trouve la réponse, je n’écrirai plus. Il vaut mieux de ne pas savoir.
- Les souvenirs sont souvent liés à l’enfance. Il a y souvent ce regret envers le passé et peu de projets, peu d’optimisme pour l’avenir. Avez vous cette vision pessimiste de l’âge qui avance ?
- Ce n’est pas tellement un regret pour la jeunesse, parce que pour moi personnellement ce n’était pas une époque idéale. Mais effectivement je crois qu’on garde un souvenir très vif de certaines choses dans son enfance peut-être parce que tout était neuf, les premiers étés, les premières rencontres avec des gens. Ceci laisse un souvenir beaucoup plus vif que par la suite, c’est dommage. L’émerveillement a tendance à se perdre et je le regrette. Je me souviens que chaque fête, chaque événement était quelque chose d’extraordinaire pour moi. Maintenant ce n’est pas banale, non, parce que j’espère que je garde cette façon de m’étonner, de m’émerveiller, mais je sens que ça s’use quand même. Par contre si on avait cette fraîcheur, on avait aussi une totale inexpérience qui nous empêchait de comprendre les gens qui nous entouraient. De ce côté là je ne suis pas tellement pessimiste parce que l’âge rend les choses plus ambiguës, plus nuancée mais aussi beaucoup plus riches.
- Dans La Part d’Ombre vous parlez des enfants qui grandissent et s’échappent à leur parents. « Les enfants prennent toute la place. Tout à coup ils ne sont plus là…. Elle ne peut même pas s’imaginer à quel point ils échappent vite, vous laissent avec vos bras trop grands. » (La Part d’Ombre, p. 81) Pensez-vous que si l’on a des enfants, l’on est condamné à se sentir vide quand ils sont grands ?
- Je pense que ceci dépend de cas mais il est vrai qu’il y a un moment quand les enfants commencent à partir, vers l’adolescence, qu’ils vous laissent les bras vides. Mais d’autre part c'est une période où l'on se fait de soucis pour eux, parce que c’est une démarche difficile. Ils sont plus indépendants mais aussi plus menacés. Ce côté maternelle, quand on peut prendre ses enfants dans les bras pour les consoler, pour les sentir tout proches, disparaît et laisse une place pour une grande inquiétude pour eux. Mais par la suite ça évolue, maintenant je peux le constater mieux qu’à l’époque où j’ai écrit ce livre. Maintenant j’ai de grands enfants adultes, c’est une autre relation, on peut discuter et partager de certaines choses qu’on ne pouvait pas avant. C’est très riche aussi. Peut-être je craignais ce vide à l’époque où j’ai écrit ce livre.
- La mort est très présente dans vos textes. Par exemple dans la nouvelle Elena (p. 96) vous écrivez : « Jusqu’à la fin elle avait espéré un regard, un sourire. Mais Elena était morte comme on tourne le dos, comme on claque la porte. » Pensez-vous que la mort est cruelle dans les souvenirs qu’elle nous laisse ?
- Mon père est mort quand j’avais 18 ans et j’ai toujours eu le sentiment d’avoir raté quelque chose. C’est peut-être à ce moment-là où j’aurais pu commencer à avoir la relation d’adulte avec lui, et je trouve ceci très cruel. Il est mort très vite sans que je puisse lui dire au revoir. Mais dans cette histoire que vous citez c’était cruel parce que la personne qui est morte s’est complètement détournée de celle qu’elle aimait de son vivant. Celle qui reste a l’impression que c’est un double ou triple mort parce qu’il n’y avait pas eu un échange. Dans la nouvelle Le Verger, par exemple, j’ai abordé la mort autrement – il y a un vieil homme qui meurt et il a l’impression de mordre dans un fruit et de voir refleurir les arbres malades de son verger. C’est une belle mort, une mort qui est ressentie un peu comme un retour du printemps, comme un épanouissement, je crois. Je pense que si l’on assiste à la mort de quelqu’un qui se révolte contre la mort, qui est amer, ça doit être très dure. Je ne sais pas comment je mourrais mais j’espère que je ne ferais pas ça à mes enfants. Si l’on arrive à avoir une certaine sérénité, peut-être cette mort serait plus acceptable pour ceux qui restent, donc tout dépend de l’attitude de celui qui meurt.
- Vous avez dit que vous être très visuelle et effectivement on rencontre dans vos textes des images qu’on ignore bien souvent dans la vraie vie, par exemple cette image de la grand-mère qui essaie de déplisser sa jupe. Que signifient ces détails pour vous ? Quelle importance ont-ils ?
- Je les remarque parce que je suis fascinée par les gens. Ces petits détails sont une façon pour moi dans mes livres de montrer ce qui pensent mes personnages. En décrivant ce geste, je décris par conséquence ce qu’ils pensent, dans quel état d’esprit ils se trouvent. Ils ont un geste qui est très révélateur d’une émotion, d’un caractère. C’est ma manière d’appréhender les gens plus peut-être que par les dialogues, probablement parce que je ne suis pas quelqu’un de dialogue. C’est vrai qu’il faut qu’on me force un peu à parler. J’ai plutôt tendance à regarder les gens toute en gardant la distance et puis les observer et parler d’eux. J’ai beaucoup de peine de rentrer en contact avec les gens et à leur parler.
- C’est vrai qu’il a y très peu de dialogue dans vos textes, l’accent est souvent mis sur le toucher, sur les gestes, les bruits. Vos personnages parlent très peu entre eux, tout se passe au-delà de mots. Dans Le Manuscrit par exemple vous dites: « Marc s’étonne de mieux se souvenir aujourd’hui des mouvements de ses mains, du dessin de ses rides, de son sourire que de ses paroles » (p. 172).
- Peut-être je me trompe mais je suis souvent déçue par un échange, par de paroles. J’ai l’impression qu’on parle beaucoup pour ne rien dire, à part quelques moments de grâce où tout à coup on rencontre quelqu’un dans une situation exceptionnelle. Je crois que 90% de choses que les gens se disent sont extrêmement superficiel, beaucoup de gens parlent par les images toutes faites, par de lieux communs, peut-être par la paresse ou par l’incapacité. On reste toujours un peu frustré tandis que si l’on observe quelqu’un, si l’on prend le moment à l’écouter, alors ça devient beaucoup plus intéressant.
- La maison est très importante dans tous vos livres. Elle est souvent ancienne, pleine de souvenirs. Qu’est-ce qu’elle représente pour vous ?
- La maison est très importante pour moi, c’est le synonyme de la famille, c’est un lieu où l’on garde ses souvenirs, où l’on vieillit. D’ailleurs les nouvelles que j’écris en ce moment tournent autour d’une seule maison avec un grand jardin. J’ai toujours rêvé d’avoir une maison et j’ai eu beaucoup de chance d’en avoir une maintenant. J’ai besoin d'un lieu où je me réfugie pour écrire tout en ayant la nature autour de moi, c’est très important pour moi.
- Dans plusieurs de vos nouvelles on retrouve souvent un chat, abandonné, solitaire qui accompagne votre personnage de loin. Qu’est-ce que le chat représente pour vous ?
- Dans la nouvelle L’étrangère par exemple il joue un grand rôle, c’est un personnage très important. Il a une manière de faire prendre conscience à ce bourreau à quel point il a perdu sa liberté, à quel point il est enfermé dans sa vie - parce que ce chat est libre, il va et vient, il aimerait en le nourrissant l’enfermer, prendre la possession de lui parce qu’il lui rappelle la jeune fille, qu’elle est aussi insaisissable, qu’elle ne se soumet pas. Donc il y a deux personnages qui ne soumettent pas, le chat et la jeune fille, et ceci le ramène à sa propre soumission. Dans cette nouvelle j’ai vraiment posé cet univers totalitaire, froid et sec contre l’univers du chat qui est celui de la liberté et du don de soi, parce qu’ils nous aiment mais ils sont libres en même temps. C’est quelque chose d’extraordinaire cette liberté du chat qui nous fait confiance, qui nous aime, qui ronronne, qui s’abandonne sur nos genoux et qui repart tout seul. Il y a la confiance et la liberté. L’acceptation par l’amour de dépasser cette sauvagerie qui lui est naturel. C’est un don extraordinaire parce qu’ils peuvent se passer de nous plus qu’un chien. J’admire leur beauté, leur noblesse, le chat n’est jamais vilain. C’est un animal qui me fascine pour toutes sortes de raisons.
- Les rapports entre les femmes sont très tendres, pleines de compassion, notamment les deux femmes dans la nouvelle De L’autre côté, mais aussi Livia et la narratrice dans Le Manuscrit, Maud et Nora dans La Part d’ombre. Pensez vous que les femmes se sentent plus proches ?
- Je ne suis pas une féministe extrémiste, mais je pense que les femmes se comprennent mieux. Elles ont une approche semblable au monde, elle réagissent similairement. Il a y un fonds commun donc la possibilité de prendre des raccourcis, la compréhension passe plus vite qu’entre une femme et un homme. Mais il faut se méfier des généralisations. Il y aura toujours une femme avec laquelle vous ne vous entendrez jamais et un homme avec lequel vous vous sentirez immédiatement en confiance.
- Vos personnages se promènent souvent autour de leur maison. Est-ce que vous aimez vous promener ?
- Non, je ne me promène pas beaucoup. Je préfère prendre le train et regarder le paysage par la fenêtre. Je pourrais rester dans un train vraiment longtemps, je trouve ça très beau. Ou de regarder la nature de la fenêtre quand je travaille. Parfois je me promène le soir, à ce moment là je regarde les fenêtres aluminées des autres maisons et je me sens très seule, comme si la vraie vie se passaient derrière les fenêtres où je n’ai pas l’accès. J’ai souvent cette impression de l’incapacité à m’intégrer.
- Quel rapport avez vous à la littérature suisse ? Avez vous des models parmi des écrivains suisses ?
- Je me sens très proche de la littérature suisse mais je dirais que ma vraie patrie est la langue française. On est chez soi dans sa langue. J’aime beaucoup les écrivains jurassiens, ce sont des écrivains assez particuliers. Le Jura est le pays de mon enfance, je lui dois une part de moi-même. C'est un pays sévère. Les gens vivent isolés dans leurs vallées, dans leur maison même parce qu'il y pleut souvent et que les hivers y sont longs. C'est un pays qui apprend à vivre seul, à être indépendant. C'est peut-être pourquoi les écrivains d'ici ne se ressemblent pas sinon dans une exigence qu'ils partagent, une exigence de sincérité. Un écrivain que j’aime beaucoup c’est Jean-Pierre Monnier. Mais d’autres aussi. On est tous influencé par ce qu’on a lu, mais à moment donné il faut oublier ces influences et trouver sa propre voix et c’est très difficile.
Merci beaucoup pour vos réponses.



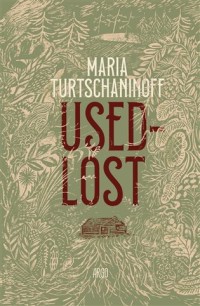


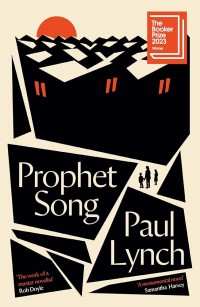
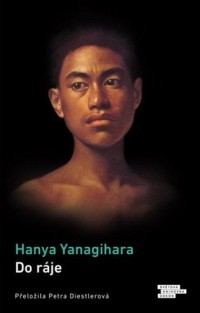


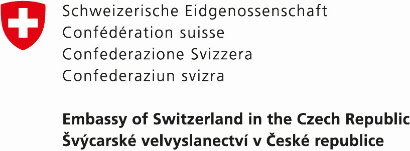




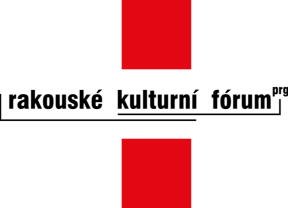


Diskuse
Vložit nový příspěvek do diskuse